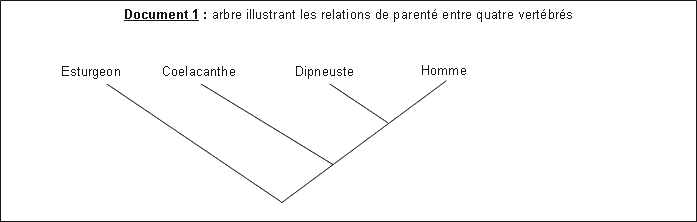
THEME OBLIGATOIRE
COMMUNICATION
NERVEUSE |
L’utilisation de la méthadone dans le traitement de la dépendance aux opiacés
La dépendance aux opiacés est un phénomène complexe où interagissent des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. L’héroïne fait partie de ces substances qui causent une forte dépendance dont certains utilisateurs réussissent très difficilement à se défaire.
Document :
Au début des années 1960, la mortalité liée à l’héroïnomanie
constituait la première cause de mortalité chez les jeunes New –Yorkais
de 15 à 35 ans. Les cas d’hépatites se multipliaient, le
nombre d’incarcérations allait croissant, alors même que
les établissements pénitentiaires ne pouvaient proposer de soins
médicaux efficaces aux toxicomanes. […]
Vincent P. Dole et Marie Nyswander développèrent avec le concours
d’un autre médecin, Mary Kreek, les premiers travaux scientifiques
relatifs aux possibilités de traitement par substitution chez les héroïnomanes.
La méthadone fut retenue à cette fin, parce qu’elle s’administrait
par voie orale et, surtout, parce qu’elle avait une action suffisamment
prolongée. Elle fut d’abord prescrite à des sujets ayant
bénéficié d’un traitement de maintenance à la
morphine. Dole, Nyswander et Kreek montrèrent qu’une posologie
(1) quotidienne comprise entre 80 et 120 mg permettait aux patients de mener
une existence socialement acceptable et bloquait les effets des drogues opiacées
qu’ils étaient susceptibles de s’injecter ; ce traitement
pouvait être prolongé de façon quasi indéfinie dans
le temps et, surtout, supprimait tout risque de manque. […]
La méthadone est un agoniste opiacé (2), comme la morphine ou
l’héroïne, et en possède donc toutes les propriétés
pharmacologiques. […]
La méthadone donne lieu à un usage addictif (3) analogue à celui
décrit avec la morphine ou l’héroïne : elle est, au
même titre, inscrite sur la liste des stupéfiants. L’arrêt
d’un traitement prolongé se traduit par des signes de sevrage
identiques à ceux décrits avec l’héroïne, mais
plus retardés dans le temps.
d’après
Denis Richard et Jean- Louis Senon,
Dictionnaires des drogues, des toxicomanies et des dépendances
(1) posologie : quantité totale d’un médicament à administrer à un
malade
(2) agoniste : qui se fixe sur les récepteurs spécifiques (ici
aux opiacés) et entraîne une réponse physiologique
(3) addictif : qui donne lieu à une dépendance
Première
question (12 points)
Mobiliser ses connaissances
| A l’aide de vos connaissances, expliquez ce qu’est la toxicomanie. |
Deuxième question (8 points)
Saisir des informations
| Présentez à partir du texte les avantages et les inconvénients de l’utilisation de la méthadone comme traitement de substitution chez des personnes souffrant de dépendance aux opiacés. |
THEME AU CHOIX
UNE
RESSOURCE NATURELLE : LE BOIS
|
La science met son nez dans le bois des tonneaux de vin.
Pas de bon vin sans bonne barrique, mais pas de bonne barrique sans bon bois. Depuis la découverte de l’aptitude qu’ont certains bois une fois chauffés, de pouvoir être pliés sans rompre, les tonneliers n’ont cessé de sélectionner les essences en fonction de leurs propriétés physiques mais aussi chimiques. « Dans sa constitution, le bois doit contenir des composés aromatiques ou phénoliques qui ne confèrent pas de défaut notoire au vin, explique Nicolas Vivas (1). Le châtaignier, par exemple, apporte des composés très amers. Depuis cinquante ans, les tonneliers n’utilisent plus que du chêne, et principalement deux espèces, le sessile et le pédonculé. Ces bois donnent des arômes de noix de coco, de clou de girofle, de vanille, et semblent être les mieux adaptés pour s’harmoniser au caractère fruité du vin. » (…)
Le secret d’un grand cru tient dans une formule : l’oxydation ménagée. Un bon tonneau est étanche mais poreux : il ne fuit pas mais il laisse passer les gaz. C’est un véritable poumon : empruntant les vaisseaux de bois, les gaz de fermentation comme le dioxyde de carbone en sortent, tandis que l’oxygène y pénètre lentement et modifie en profondeur la composition du vin. Pendant les seize à dix-huit mois qu’un grand cru passe dans son berceau de bois, le vin s’éclaircit et se stabilise grâce à l’apport en oxygène : les acides tartriques précipitent, les tanins les plus agressifs s’assouplissent et les anthocyanes (responsables de la couleur) se fixent.
Le choix du bois est donc essentiel pour que le vin ne respire ni trop, ni trop peu. Les essences à fibres serrées, correspondant à des arbres à croissance très lente – moins d’un mm de diamètre par an – sont les plus recherchées.
d’après Pierre Barthélémy, le Monde, jeudi 14 mai 1998
(1) Nicolas Vivas est responsable d’un laboratoire
de
recherche dans
une grande industrie de tonnellerie.
Première
question (10 points)
Saisir des informations
| Relevez dans le document les informations qui montrent que la nature et la structure du bois conditionnent son utilisation dans la fabrication des tonneaux. |
Deuxième question (10 points)
Mobiliser ses connaissances
| Montrez que la structure transversale d’un tronc d’arbre donne des indications sur son mode de croissance. |
THEME AU CHOIX
PLACE
DE L’HOMME DANS L’EVOLUTION
|
La classification des Vertébrés
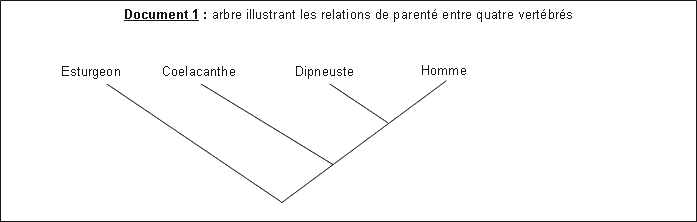
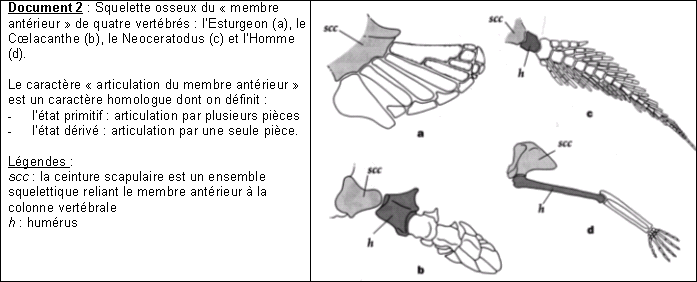
d’après « Classification phylogénétique du vivant » Guillaume Lecointre - Hervé Le Guyader
Première
question (8 points)
Saisir des informations et utiliser ses connaissances
| Montrez en quoi le document 2 permet d’apporter des arguments en faveur de la position des quatre vertébrés dans l’arbre du document 1. |
Deuxième question (12 points)
Mobiliser ses connaissances
| Situez l’Homme dans la classification des Vertébrés en rappelant les caractères qu’il partage avec les organismes des groupes auxquels il appartient. |