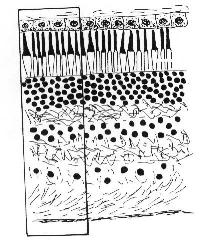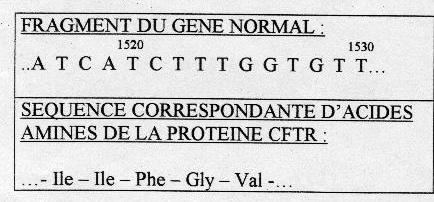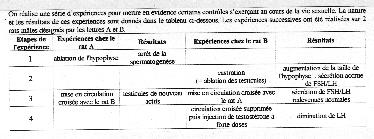Résumé
de la journée de formation "évaluation anticipée au baccalauréat en 1°L et
1°ES" (stage n° OOKCC8OON) |
AUTEURS
: Emmanuelle FRANCOIS, Alexis PIETTRE, participants au stage pour les travaux de groupe,
mise en forme internet Emmanuelle FRANCOIS
PRESENTATION : Résumé complet de la journée de formation (8 novembre 2000)
"évaluation anticipée au baccalauréat ES et L" intégrée au stage n°
OOKCC800N - Textes officiels, informations pratiques, proposition de sujets, évaluations
formative et sommative.
MOTS-CLES : SVT - Première L - Première ES - Evaluation sommative - Evaluation
formative
PUBLIC VISE : Enseignants de SVT en lycée (premières L et ES)
OBJECTIF PRINCIPAL : Permettre une meilleure compréhension de l'esprit des sujets de
baccalauréat (étude des sujets "zéro") , fournir quelques exemples de sujets,
envisager une évaluation progressive des compétences demandées aux candidats.
CONTACTS : Emmanuelle FRANCOIS didier.thellier@wanadoo.fr
et Alexis PIETTRE alexis.piettre@wanadoo.fr
PLAN
DU DOSSIER
Textes
officiels
1° ES
Extraits de la note de service DESCO A3
(accompagnant les programmes)
Nombre de parties : 1 des 3 thèmes
obligatoires, 1 des 4 thèmes au choix
Durée : 1h30 ( 2 x 45')
Coefficient : 2
Compétences testées : culture scientifique et
réflexion critique
Formulation des questions : 2 à 3 questions courtes
d'importance égale, indépendantes les unes des autres appelant des réponses brèves
Supports : texte scientifique d'actualité et (ou)
documents
Notation : chaque partie sur 20 points répartis
sensiblement à égalité entre les différentes questions
Extraits de la note aux auteurs de sujets (
accompagnant les sujets "O")
Nombre de questions
: 2 questions indépendantes conseillées par partie ( 3 au maximum)
Supports : texte scientifique ( 15 à 20 lignes)
référencé (validité scientifique) et coupé au maximum 4-5 fois ou document montrant
des résultats expérimentaux.
Nombre de document : 1 document par partie
Objectifs des questions :
*Question de compréhension du document : saisie d'informations, mise en
œuvre du raisonnement amenant à dégager les notions fondamentales
*Question de culture scientifique : mobilisation et mise en relation
des connaissances afin d'argumenter de façon critique les enjeux de société
Présentation : une page par partie, un seul verbe
d'action par question, compétence évaluée par question indiquée, longueur de la
réponse attendue indiquée, barème indiqué
1° L
Extraits de la note de service DESCO A3
(accompagnant les programmes)
Durée : 1h30
Coefficient : 2
Nombre de parties : 1 des 2 thèmes obligatoires communs
avec des questions de SVT et des questions de PC, 1 des thèmes au choix de SVT ou
le thème "enjeux planétaires énergétiques"
Compétences testées : culture scientifique et
compréhension des enjeux de société
Supports : textes scientifique, document relatant des
faits d'observation ou d'expériences…
Notation : la première partie de l'épreuve (commune
SVT-PC) représente la majorité des points répartis à égalité entre les 2 disciplines
 Retour au plan du dossier
Retour au plan du dossier
Informations pratiques
 Retour au plan du dossier
Retour au plan du dossier
Sujets type
baccalauréat
Pour les différents thèmes abordés ci-après, vous
trouverez des propositions de formateurs à partir de différents supports et des
propositions de stagiaires ayant travaillé sur ces mêmes supports. Ces documents et
propositions ne sont en aucun cas des modèles mais seulement des pistes de travail.
1°L : Représentation visuelle du
monde (Th.oblig)
Proposition des formateurs
Niveau, sujet et
supports proposés |
Support retenu
(remédiation éventuelle), formulation des questions, compétences évaluées |
1°L : Représentation
visuelle du monde (Th.oblig)
Document 1 : texte historique (Celse, auteur latin du I°
siècle avant J.C)
Document 2 : Coupe de rétine
|
Support
retenu : texte
1-Refaites la description de Celse dans le même style condensé
(10 à 15 lignes) en modifiant chaque fois que cela vous semble nécessaire, soit pour la
corriger , soit pour la compléter
à saisie
d'informations
à mobilisation de
connaissances
2-Expliquer en quoi la perception visuelle individuelle de notre
environnement est dépendante de l'organisation cérébrale des réseaux de neurones
à mobilisation de
connaissances
(à argumentation /
choix individuel et de société) |
|
Document 1 : "L'oeil est recouvert de deux
membranes. Les grecs appellent la plus externe kératoïde; elle est assez épaisse dans
sa partie blanche et s'amincit à l'emplacement d ela pupille. Une autre, plus
intérieure, lui est soudée; elle est percée, en son milieu, d'un petit trou, là où se
trouve la pupille; assez mince en cet endroit, elle s'épaissit à mesure qu'elle s'en
éloigne. Les Grecs l'appellent choroïde. Ces deux membranes, après avoir enveloppé
toutes les parties intérieures de l'oeil, viennent se réunir par dessous,
s'amincisssent, se confondent l'une avec l'autre et, passant par une fente des os,
parviennent à la membrane du cerveau et se fixent à elle.
D'autre part, au-dessus de la pupille se trouve un
expace vide tapissé d'une très mince tunique nommée arachnoïde par Hérophile; elle
renferme dans sa cavité une substance que les Grecs, d'après sa ressemblance avec le
verre, ont appelée hyaloïde. Cette subtance n'est ni liquide, ni sèche, c'est une sorte
d'humeur condensée, produite par l'intérieur de l'oeil et enveloppée d'une petite
membrane. Incluse dans le tout, se trouve une goutte d'humeur semblable à du blanc
d'oeuf, dans laquelle réside la faculté de voir, et que les Grecs désignent sous le nom
de crystalloïde (appelé cristallin actuellement)"
Celse, auteur latin du I° siècle
avant J.C |
Document 2 :
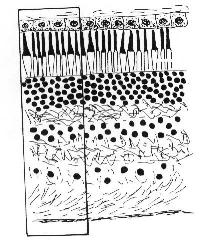
|
Proposition
de stagiaires
Question
proposée à partir du document 1 : Evaluez la validité
scientifique de la dernière phrase de chaque paragraphe en relevant 3 erreurs que vous
corrigerez à l'aide de vos connaissances.
Attentes :
Erreur :
"kératoïde et choroïde parviennent à la membrane du cerveau" --->
correction attendue : ces membranes sont localisées exclusivement au niveau du globe
oculaire. C'est le nerf optique qui parvient au cerveau.
Erreur : "goutte
d'humeur" --> correction attendue : vocabulaire inadapté, actuellement on parle
d'humeur pour l'humeur acqueuse et l'humeur vitrée.
Erreur : "blanc
d'oeuf" ---> correction attendue: le cristallin a une consistance plus solide.
Erreur : "réside
la faculté de voir" --> correction attendue : le cristallin est un milieu
transparent . C'est seulement un des éléments du processus visuel ( à expliquer)
1°L (Th. Au
choix) , 1°ES (Th.Oblig) : du génotype au phénotype, applications biotechnologiques
Proposition des formateurs
Niveau, sujet et supports proposés |
Support retenu (remédiation éventuelle), formulation des questions,
compétences évaluées |
1°L (Th. Au
choix) , 1°ES (Th.Oblig) : du génotype au phénotype, applications biotechnologiques
Document 1 : Texte " la caille …"
Document 2 : Texte mucoviscidose + tableau de mutations au niveau de
la séquence d'ADN et de la séquence polypeptidique
|
Support choisi : texte "la Caille"
1-A partir des informations tirées du texte,
retrouver les différentes étapes d'obtention d'un mammifère transgénique aboutissant
à la production de lait contenant un anticoagulant.==> saisie
d'informations
2-Expliquer les intérêts et les dangers
d'obtention de volailles transgéniques clonées.==> mobilisation de connaissances et argumentation choix de société
Support
choisi : texte mucoviscidose (modifié gène par allèle)
1-A l'aide des informations du texte, montrer
que le phénotype de la mucoviscidose peut être expliqué à différentes échelles :
macroscopique, cellulaire et moléculaire.==> saisie
d'informations
2-Exposer en quoi la découverte du gène de la
mucoviscidose et de ses allèles permet d'envisager des applications dans le domaine
médica. ==> mobilisation de connaissances et argumentation
choix de société |
| Document 1 : "La Caille japonaise deviendra-t-elle un jour la cheville ouvrière des
industries pharmaceutiques? Détronera-t-elle à ce titre la chèvre et la vache à lait
d'or, sur lesquelles les chercheurs fondent actuellement l'essentiel de leurs espoirs ? Il
est encore trop tôt pour le prédire. Mais la volaille tient désormaissa place sur la
scène prestigieuse des animaux "transgéniques"
Les animaux transgéniques, qui ont intégré dans
leur patrimoine héréditaire un ou plusieurs gènes étrangers, offrent des perspectives
économiques considérables. Génétiquement modifiés de manière à produire dans un
fluide biologique (le lait, par exemple) des protéines d'intérêt pharmaceutique, ils
servent en quelque sorte de "fermenteurs vivants". Avec un avantagenon
négligeables sur les bactéries, les levures ou les cellules végétales : leurs
cellules, animales come les nôtres, fabriquent des protéines humaines d'une structure
très similaire à leur structure d'origine.
Par ce procédé, développé à l'échelle
industrielle depuis une dizaine d'années, quelques firmes ont déjà obtenu des centaines
de chèvres transgéniques, dont le lait regorge d'antithrombine III ( un anticoagulant),
de lactoferrine (une protéine fixatrice de fer) ou d'alpha-1-antitrypsine, trois
protéines humaines qui font désormais l'objet d'essai
cliniques. Mais les chercheurs continuent à se heurter à un obstacle de taille : les
gros mammifères transgéniques restent une denrée rare, difficile à fabriquer. Pour
voir naître quelques animaux viables, des milliers d'embryons doivent être manipulés.
Autant dire qu'il s'agit d'un procédé de luxe, réservé à la production de substances
à très haute valeur ajoutée. A moins, bien sûr, d'améliorer son rendement. C'est ce
que promet la technique du clonage, qui permettrait de reproduire, à grande échelle et
de manière accélérée, la chèvre ou la vache adéquate. C'est ce que propose
peut-être aussi une autre voie de recherche, encore balbutiante : l'obtention de
volailles transgéniques. Poulet, dinde ou caille, les oiseaux d'élevage présentent sur
les gros mammifères l'avantage de leur petite taille et, surtout, de leurs mode et
vitesse de reproduction. La collecte dans le blanc de leurs oeufs d eprotéines humaines
d'interêt médical se révèlera-t-elle plus simple et moins onéreuse que dans le lait
de chèvre ou de vache ?. C'est ce qu'espèrent nombre de chercheurs qui, parallèlement
aux travaux menés sur les mammifères, commencent à étudier la transgénèse chez les
oiseaux.
Extrait de "L'industrie pharmaceutique
s'interesse aussi aux volailles transgéniques" de Catherine Vincent dans Le Monde
électronique (mise à jour le 2/10/99) |
Document 2 : Cette maladie touche en France 1 enfant sur 2000. Cette
fréquence élevée en fait la plus grave des maladies géniques.
A partir d'une erreur génétique, tous les
organes sécrétant du mucusvont se trouver bloquer dans leur fonctionnement,
particulièrement les muqueuses pancréatiques et respiratoires. Le mucus anormal car
très visqueux (d'où le nom d ela maladie : "muco" de mucus et
"viscidose" de visqueux) crée un obteacle qui se traduit au niveua des poumons
par une gène respiratoire et tout effort devient impossible. Au niveau intestinal, les
douleurs abdominales se répètent à la moindre erreur alimentaire. Les occlusions
intestinales sont fréquentes. Le déséquilibre nutritionnel entraîne un aspect chétif
et un retard de croissance. On observe également une obstruction des canaux
pancréatiques empêchant le sécrétion des enzymes digestives.
Le gène impliqué dans la mucoviscidose a
été découvert en 1989. Chez les personnes non malades, il code pour une protéine de
1480 acides aminés, appelée CFTR car elle est impliquée dans la sortie de l'eau des
cellules. Chez ces personnes, les sécrétions pancréatiques et de scellules bronchiques
sont diluées, donc fluides.
En France,70% des personnes atteintes d e
mucoviscidose possèdent un gène muté, ayant perdu les trois nucléotides codant pour
l'acide aminé n° 508 dela protéine CFTR. Celle-ci, anormale, n'assure plus sa fonction.
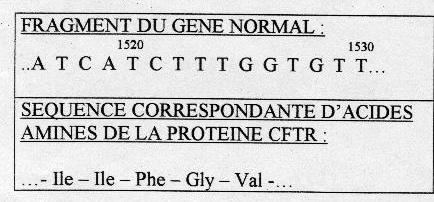

|
Proposition
de stagiaires
Question 1 : Exploiter un texte (10 points)
Montrez l'intérêt que présentent les volailles dans la
transgénèse par rapport aux autres espèces.
2 attentes : -comparaison avec les mammifères et comparaison avec les procaryotes
et végétaux
Question 2 : Maîtriser des connaissances (10 points)
Rappelez les principes de la transgénèse et les perspectives et
dérives de cette technique. Vous pouvez vous appuyer sur un exemple que vous connaissez
Attentes : restitution de cours correcte ( idées, vocalulaire scientifique) et
esprit critique.
1°ES (Th.oblig) et
1°L (Th.choix) : Procréation
Proposition des formateurs
Niveau, sujet et
supports proposés |
Support retenu
(remédiation éventuelle), formulation des questions, compétences évaluées |
|
1°ES
(Th.oblig) et 1°L (Th.choix) : Procréation
Document 1 : Tableau relatant des faits expérimentaux
Document 2 : Texte extrait du Nouvel Observateur
Document 3 : Texte "témoignage du lutteur …"
|
Supports
choisis : Tableau d'expériences ( à modifier en rajoutant la production de testostérone
) + texte (Nouvel Obs.)
1-A l'aide des informations tirées du tableau montrer comment se
réalise la production de testostérone.==> saisie d'informations
et mise en relation de données
2-Exposer comment les stéroïdes anabolisants peuvent être utilisés
comme substances dopantes.==>mobilisation de connaissances ou
saisie d'informations et argumentation choix de société
Support choisi : texte "lutteur suédois"
1-A partir des informations du texte, indiquer les effets liés à
la prise d'hormones andogènes en faisant apparaître les relations de causes à effets.==> saisie d'informations et mise en relation de données
2-Exposer comment se réalise la production de testostérone au sein de
l'organisme.==> mobilisation de connaissances ou saisie
d'informations |
| Document 1 :
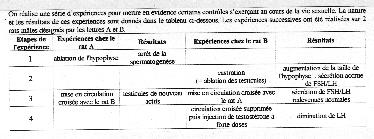
Pour mieux visualiser le document ci-dessus |
Document 2 : "Je
sentis mon énergie décupler deux mois après le début du traitement (c'est à dire
l'injection de testostérone de synthèse), j'avais rattrapé mon retard sur l'élite
mondiale en douze piqûres!...Un an après j'accumulais les accidents musculaire
:distension ligamentaire, déchirure musculaire. J'étais devenu trop fort pour mes
tendons et mes fibres musculaires...Quatre mois avant les jeux de Munich, je fus
cloué au sol par un nouvel accident musculaire en courant : déchirure d'un des muscles
du mollet. Jamais cela ne m'étais arrivé en dix-huit ans de pratique sportive. Lors des
préliminaires du tournoi olymppique, une douleur fulgurante me déchira le dos, de bas en
haut jusqu'à la nuque.Je sombrai dans l'inconscience...Quand je reviens à moi, j'étais
allongé sur une table de massage dans les vestiaires. Je ne pouvais plus bouger ; mon
bras gauche et tout le côté gauche de mon thorax étaient morts: le médecin de notre
délégation était penché sur moi : " votre grand dorsal est complètement
déchiré. Les jeux sont terminés pour vous."
Mon histoire "exemplaire" m'incite furieusement à lancer une
mise en garde à l'ensemble des athlètes de toutes les disciplines sur les dangers des
anabolisants. Arrêtez cette folie!. Ces hormones androgènes provoquent des ravages dans
l'organisme : dérèglement du métabolisme du calcium, ralentissement de la fonction
d'élimination du foie, cancer de la prostate, etc...Leur effet "bénéfique"
sur les masses musculaires ne peut durer qu'un temps car les fibres hypertrophiées
imposent aux tendons, aux ligaments et aux articulations des efforts qu'ils ne peuvent
soutenir. Un squelette prévu pour supporter 80 kg en supporte difficilement 30 à 40 de
plus. Alors les tendons se rompent et les articulations se déforment. Le sportif est
déchu et l'homme est handicapé pour la vie "
D'après le témoignage du lutteur suédois Pelle
Svenson, médaille d'argeznt aux jeux olympiques de Tokyo |
Document 1 :

Proposition
de stagiaires
Support :
tableau
Question
1 : compréhension de document
Indiquer les relations
entre les organes mises en évidence par les expériences présentées dans le tableau (un
texte d'une dizaine de lignes illustré par un schéma est attendu)
Attentes : repérer les
organes, mettre en relation ces organes (circulation, voir sanguine, communication
hormonale), déduction à partir des résulats de chaque expérience,réalisation d'un
schéma.
Question 2 :
culture scientifique
En quoi le domaine
médical peut-il intervenir lors d'un déficit en testostérone chez l'homme adulte ?
Attentes : indiquer les
conséquences du déficit sur la spermatogénèse et la fertilité puis expliquer le
principe des PMA incluant les problèmes éthiques
1°L (Th.oblig)
et 1°ES (Th.choix) : Alimentation, production alimentaire et
environnement
Proposition des formateurs
Niveau, sujet et
supports proposés |
Support retenu
(remédiation éventuelle), formulation des questions, compétences évaluées |
|
1°L (Th.oblig) et 1°ES
(Th.choix) : Alimentation,
production alimentaire et environnement
Document 1 : Texte internet sur la malnutrition protéino-énergétique http://perso.club-internet.fr/cognacq/pediatrie5.html
Document 2 :tableau relatant des faits d'observations et des faits
expérimentaux sur le kwashiorkor. Manuel BORDAS 1°S ( septembre 88)
Document 3 : Texte internet sur l'obésité
http://www.frm.org
|
Support
choisi :document 1: texte MPE à reformuler (définition à garder, signes cliniques à
trier en ne gardant que les signes communs au kwashiokor et au marasme, épidémiologie)
1-Dégager du texte les différentes causes directes et indirectes
et les conséquences des MPE ==> saisie d'informations et
argumentation choix de société
2-Définir les principes de bases de l'équilibre nutritionnel d'un
enfant sevré ==> mobilisation de connaissances
--------------------------------------------------------------------
Support choisi : document 2 : tableaux kwashiokor (faits
d'observation)
1-Exploiter les tableaux afin de dégager les causes possibles du
kwashiokor ==> saisie d'informations et mise en relation de
données
2-Définir les principes de bases de l'équilibre nutritionnel d'un
enfant sevré ==> mobilisation de connaissances
Support choisi : document 3 : texte internet à reformuler
1-Exploiter les informations apportées afin de dégager et de
discuter les différentes causes possibles de l'obésité chez l'homme ==> saisie d'informations et argumentation
2-Al 'aide de vos connaissances définir les principes de bases d'une
alimentation équilibrée chez l'enfant ==> mobilisation de
connaissances |
1°ES (Th.obligatoire) : Communication nerveuse
Proposition des formateurs
1°ES (Th.obligatoire) : Communication nerveuse
SUPPORT DOCUMENTAIRE SUR LE THEME "COMMUNICATION
NERVEUSE"
Voici un texte rassemblant des
extraits de pages Internet issues de "www.drogues.gouv.fr" , site de la Mission
Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT) ; on se trouve
dans la partie "informations sur les drogues" de ce site.
..."Sont présentés dans les pages suivantes les
produits les plus souvent consommés en France : cannabis, cocaïne, ecstasy, héroïne,
alcool, tabac…Quelle que soit la substance, le cerveau est la première cible.
Cocaïne, ecstasy, tabac, alcool, morphine, tous les produits qui déclenchent une
dépendance chez l'homme ont en commun une propriété : ils augmentent la quantité de
dopamine, un neuromédiateur, disponible dans une zone du cerveau, le " circuit de
récompense ". […] La dopamine est libérée dans le fin espace entre les deux
neurones. Elle agit en se fixant sur des récepteurs portés par le neurone récepteur. La
dopamine est ensuite recaptée par le neurone émetteur et détruite par une enzyme. La
stimulation des neurones à dopamine produit une sensation de plaisir intense. L'individu
cherchera alors à le ressentir à nouveau avec le ou les produits utilisés. Un
mécanisme simple et systématique qui explique pour partie les comportements de
consommations répétitives que beaucoup de personnes connaissent ou observent.
[…liste des différentes drogues]
LES OPIACES
Origine
Les opiacés désignent différents produits
extraits de l'opium, substance obtenue à partir du Papaver Somniferum. Ses alcaloïdes
naturels sont la morphine et la codéine ; les composés
synthétisés sont l'héroïne et la buprénorphine (SUBUTEX, TEMGESIC), la méthadone, le
propoxyphène ou le fentanyl.
Effets
L'effet en début de consommation est celui
d'une euphorie intense (flash), tout particulièrement pour l'héroïne, associée
à une sensation cutanée de la base de l'abdomen de type orgasmique (rush). Au
bout de quelques semaines de prises répétées, ces effets peuvent disparaître au
profit d'une consommation servant seulement à éviter les effets du manque.
Mécanismes d'action
L'héroïne passe plus rapidement que
d'autres substances dans le cerveau où elle est transformée en morphine. On connaît de
nombreuses zones cérébrales sensibles aux opiacés. C'est là que se créent
naturellement les endomorphines du cerveau. On peut noter aussi une forte densité de
récepteurs dans la moelle épinière, ce qui explique l'action analgésique de la
morphine. La morphine stimule également le système de la dopamine mais par un mécanisme
indirect en diminuant le contrôle négatif des neurones à GABA sur les neurones à
dopamine.
EVALUATION SOMMATIVE TYPE BAC BLANC
QUESTIONS
1°/ A l'aide
des informations tirées du texte, montrez comment la prise d'héroïne procure une
sensation de plaisir. Votre réponse sera réalisée sous forme d'un schéma illustrant le
fonctionnement d'un réseau de neurones cérébraux. ===>saisir
des informations, mettre en relation des données et communiquer à l'aide d'un schéma
2°/
Expliquez l'origine synaptique du phénomène de dépendance à l'héroïne.==>mobiliser
ses connaissances
Proposition
de stagiaires
Question 1 :
En vous appuyant sur le texte et à l'aide de vos connaissances, réalisez un schéma
expliquant pourquoi la présence de morphine engendre une libération accentuée de
dopamine
Indicateurs de
correction :
La morphine se fixe sur des
récepteurs opioïdes à la place des enképhalines. La sécrétion de GABA est bloquée,
le neurone à dopamine peut alors sécréter davantage d edopamine (Cf texte)
Schéma attendu :

 Retour au plan du dossier
Retour au plan du dossier
Apprentissage
progressif des objectifs méthodologiques (
L'objectif du travail proposé ci-dessous est de proposer des
questionnaires progressifs à partir d'un seul support permettant de réaliser un
apprentissage de certaines compétences évaluées lors de l'épreuve finale :
THEME: " du
génotype au phénotype,applications biotechnologiques" (sujet II des annales)
On suppose la notion de gène, d'allèles, de
génotype diploïde, de phénotype connues
|
EVALUATION
FORMATIVE (activités) |
EVALUATION
SOMMATIVE ( D.S) |
Début d'année
|
1-Quel
est le nom de l'hormone de satiété ? (I)
2-Où est-elle produite ? (I)
3- Quelle est la conséquence d'une augmentation de la masse du tissu
adipeux chez un individu non obèse ? (I)
4-Schématiser les relations existant entre tissu
adipeux et hypothalamus (Ra)
5-Dans quels cas la leptine est-elle
inefficace ? (I)
6-Souligner dans le texte les informations relatives au génotype
"obèse" (I)
7-Ecrire ces génotypes ©
8-Sur le schéma réalisé en Q4 indiquer les
informations trouvées sur le génotype et faire apparaître le phénotype. (Ra) |
1-Souligner
les informations du texte relatives aux génotypes de personnes obèses
Critère de réussite : bien trier les informations - Ne
souligner que les passages en rapport avec la question
2-Ecrire ces génotypes
Critère de réussite : respecter l'écriture donnée en classe
3-Expliquer pourquoi de tels génotypes conduisent au
phénotype obèse
Critère de réussite : relier production de leptine - tissu
adipeux - hypothalamus - génotype - récepteur - centre de la satiété - phénotype |
Milieu d'année
|
1-Souligner
dans le texte les conséquences de l'augmentation de la masse du tissu adipeux chez une
personne non obèse (I)
2-Repérer et écrire les différents génotypes de personnes obèses (I) ©
3-Mettre en relation la question 1 et 2 afin
d'expliquer le lien entre génotypes et phénotype "obèse" (Ra)
|
1-Repérer et
écrire les différents génotypes de personnes obèses
2-Expliquer pourquoi de tels génotypes conduisent au phénotypes
"obèse"
Critères de réussite :
*bien repérer les 2 causes possibles de la non efficacité de la
leptine
*repérer la conséquence de la synthèse de leptine chez un individu
non obèse |
Fin
d'année
|
1-Trouver
les différents génotypes de personnes obèses (I)
2-Expliquer les conséquences de tels génotypes
sur l'apparition de l'obésité (RA)
ou
1-Trouver dans le texte des arguments indiquant
pourquoi les personnes possédant deux allèles mutés du gène de synthèse de la leptine
ou de synthèse du récepteur de la leptine développent un phénotype "obèse"
.(A) |
1-Expliquer les différentes origines d'un
phénotype "obèse"
ou
1-Trouver dans le texte des arguments indiquant pourquoi les personnes
possédant deux allèles mutés du gène de synthèse de la leptine ou de synthèse du
récepteur de la leptine développent un phénotype "obèse" .(A) |
THEME: "
communication nerveuse"
Texte rassemblant des extraits de pages Internet issues de "www.drogues.gouv.fr"
(voir ci-dessus élaboration de sujets)
EVALUATION
FORMATIVE : ACTIVITES EN TRAVAUX DIRIGES
[pré requis : bases de la communication nerveuse vues ; niveau
médullaire étudié ; notions d'opiacés endogènes et exogènes connues]
| QUESTIONS |
OBJECTIFS
METHODOLOGIQUES |
| 1°/ Que
signifie "neurone à GABA " ? |
mobiliser
ses connaissances |
| 2°/ Quelle est
l'action d'un neurone à GABA sur un neurone à dopamine ? |
saisir
des informations |
| 3°/ Quelle est
l'action de la morphine sur un neurone à GABA ? |
saisir
des informations |
| 4°/ Pourquoi la
morphine entraîne-t-elle finalement une entrée en activité du centre du plaisir ? |
saisir
des informations |
| 5°/ La morphine
se substitue en fait aux neurones cérébraux à enképhalines. En vous appuyant sur les
réponses précédentes et par analogie avec le schéma du cours décrivant l'action des
neurones médullaires à enképhalines sur les synapses à substance P, construisez un
schéma analogue montrant l'action cérébrale des neurones à enképhalines sur les
neurones à GABA et les neurones à dopamine. |
mobiliser
ses connaissances, mettre en relations des informations dans un but explicatif et
communiquer à l'aide d'un schéma |
| 6°/ On a
constaté que la morphine et la méthadone se liaient aux mêmes récepteurs morphiniques
situés sur le neurone à GABA, pourquoi ? |
saisir
des informations |
| 7°/ Rappelez ce
qu'est un médicament de substitution et expliquez pourquoi la méthadone peut jouer ce
rôle. |
mobiliser
ses connaissances et mettre en relations des informations dans un but explicatif |
EVALUATION SOMMATIVE EN COURS
DE THEME
[dépendance
et tolérance pas encore expliquées en cours]
| QUESTIONS |
OBJECTIFS
METHODOLOGIQUES |
1°/ A l'aide de
vos connaissances, complétées par le texte, schématisez le fonctionnement d'une synapse
à dopamine.
critère
de réussite
: bien distinguer ce qui vient du cours et ce qui est rajouté par le texte |
mobiliser
des connaissances (le schéma de synapse du cours) et saisir des informations
(complément, grâce au texte, sur le recyclage de la dopamine) |
| 2°/ Rappelez
sous forme de schéma le contrôle médullaire des neurones à enképhaline sur les
synapses à substance P. |
mobiliser
ses connaissances |
| 3°/ Par analogie
avec le schéma précédent et en vous appuyant sur le texte, expliquez pourquoi la présence de morphine dans le cerveau
a pour conséquence finale une libération accentuée de dopamine.
critère de réussite : ne pas mélanger les deux niveaux
(médullaire et cérébral) mais bien se servir de l'un pour expliquer l'autre |
saisir
des informations et mettre en relation des informations dans un but explicatif |
| 4°/ Pourquoi la
prise de médicaments dits de substitution, contenant de la buprénorphine ou de la
méthadone, peut-elle calmer les toxicomanes et réduire les troubles du manque lors de la
période d'arrêt de la consommation ? |
mettre
en relation des informations dans un but explicatif |
EVALUATION SOMMATIVE TYPE BAC BLANC
| QUESTIONS |
OBJECTIFS
METHODOLOGIQUES |
| 1°/ A l'aide
des informations tirées du texte, montrez comment la prise d'héroïne procure une
sensation de plaisir. Votre réponse sera réalisée sous forme d'un schéma illustrant le
fonctionnement d'un réseau de neurones cérébraux. |
saisir
des informations, mettre en relation des données, communiquer à l'aide d'un schéma |
| 2°/
Expliquez l'origine synaptique du phénomène de dépendance à l'héroïne. |
mobiliser
ses connaissances |
 Retour au plan du dossier
Retour au plan du dossier