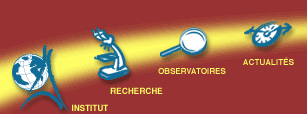


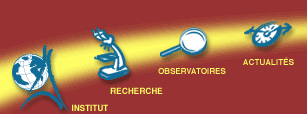 |
 |
 |
| |
|

Les Panaches du manteau
Cinzia Farnetani PhD - Laboratoire de Dynamique des systèmes géologiques
La plus grande partie du volcanisme terrestre a lieu à proximité des marges des plaques : aux dorsales océaniques, là où les plaques divergent, et dans les zones de subduction, là où les plaques convergent. Cependant, le volcanisme se produit aussi au milieu des plaques, comme à Hawaii, dans l'océan pacifique, et qui est le volcan le plus actif du monde, ou à la Réunion, dans l'océan indien. Depuis les années 70, on pense que ce type de volcanisme est dû aux panaches provenant du manteau. On l'appelle aussi volcanisme de point chaud.
Où se forment les panaches ?
Un panache est constitué de matériau plus chaud, et donc moins dense, que le manteau environnant. Ce matériau chaud remonte vers la surface terrestre, où il produit des éruptions volcaniques. La source la plus probable de ce matériau est une fine couche limite thermique, où la température varie rapidement sur une faible épaisseur. La couche limite thermique la plus importante se situe à une profondeur de 2900km, à la frontière entre le manteau terrestre et le noyau. Cette couche est sans doute instable, et quand elle se déstabilise, elle libère des bouffées de matériau chaud qui remontent vers la surface.
Peut-on imaginer la forme d'un panache ?
Pensez à un champignon ! Les expériences de laboratoire avec des fluides visqueux, aussi bien que les expériences numériques, ont montré que l'instabilité d'une couche thermique engendre des panaches. Etant donné que la viscosité du matériau chaud dans le panache est inférieure à celle du manteau environnant, le panache a une grosse "tête" presque sphérique, (de quelques centaines de km de diamètre), suivie par une "queue" plus étroite (de 100 à 200km de diamètre). La queue alimente la tête du panache en matériau provenant de la couche thermique située au bas du manteau.
Quel type de volcanisme est associé à un panache isolé ?
Un grand volume de matériau chaud est présent dans la tête du panache. On peut donc s'attendre à ce qu'un volcanisme exceptionnellement intense se produise quand la tête arrive à la base de la lithosphère (100 à 150 km de profondeur). Le matériau chaud qui remonte dans la queue donnera ensuite lieu à un volcanisme plus faible, mais qui peut perdurer pendant une centaine de millions d'années.
A-t-on des observations pour confirmer cette hypothèse ?
On pense que, dans le passé, il y a eu des phénomènes volcaniques catastrophiques, d'une ampleur et intensité étonnante, qui ont conduit à la formation d'immenses plateaux de basaltes continentaux, appelés traps. Les exemples les plus connus (figure ci-dessous) sont les traps de Sibérie, datés de 249 Ma (à la limite entre le Permien et le Triassique), les traps du Parana, en Amérique du Sud, datés de 133 Ma, et celles du Deccan, en Inde, datés de 68 Ma (à la fin du Cretacée). Pour constituer ces vastes plateaux de basalte continentaux, des millions de kilomètres cubes de lave ont dû jaillir en quelques millions d'années, ce qui est considéré comme instantané à l'échelle des temps géologiques !
Répartition des grands traps à la surface de la Terre d'après "La vie en catastrophe" V. Courtillot ed Fayard 1995
Comment montrer que les plateaux de basalte continentaux sont liés aux points chauds ?
Imaginez que l'on bouge un bout de papier au-dessus d'une bougie et regardez la "trace laissée" sur le papier... Imaginez maintenant une plaque lithosphérique bougeant au-dessus d'un point chaud, qui, en première approximation, reste relativement fixe (car sa vitesse de déplacement est très faible par rapport à la vitesse des plaques). La "trace laissée" sur la plaque en déplacement constitue une chaîne des volcans dont l'âge croit en s'éloignant du point chaud. On peut reconstruire les mouvements des plaques en faisant "bouger" les plaques en "marche arrière". On détermine ainsi la position de chaque plaque dans le passé. C'est ainsi que l'on a fait l'extraordinaire découverte qu'à l'époque de sa formation, le plateau de basalte se trouvait au-dessus d'un point chaud, et qu'une chaîne de volcans d'âges croissants reliait le plateau au point chaud, souvent encore actif aujourd'hui !
La formation des plateaux de basaltes continentaux aurait-t-elle eu un impact sur le climat ?
L'effet sur le climat de l'activité volcanique dépend de nombreux facteurs, dont les plus importants sont le type de volcanisme, la composition des gaz émis dans l'atmosphère (surtout le soufre et le gaz carbonique), et la latitude des volcans. Un scénario catastrophique ne peut pas être exclu : on peut imaginer une atmosphère obscurcie à cause des poussières volcaniques, des effets climatiques anormaux pendant plusieurs années avec une baisse de température de plusieurs degrés et des pluies acides. Les conséquences sur le milieu vivant pourraient avoir été très importantes. La correspondance dans le temps entre la formation des plateaux de basaltes continentaux et certaines extinctions en masse de très nombreuses espèces pourrait être plus qu'une simple coïncidence ….
Peut-on "voir" des panaches dans le manteau ?
En géophysique, on peut "voir" l'intérieur de la Terre, grâce à la sismologie. Dans le manteau plus chaud qui forme un panache, les ondes sismiques voyagent plus lentement que dans le manteau environnant. On peut donc s'attendre à enregistrer des retards dans les temps d'arrivée des ondes sismiques qui ont traversé un panache. Les observations sismiques sous l'Islande, par exemple, montrent la présence d'anomalies de vitesse dans tout le manteau supérieur. Toutefois, la détection d'autres panaches dans le manteau reste encore un défi pour les sismologues.
Que nous apprend la géochimie des roches associées aux panaches ?
Les analyses géochimiques nous apprennent que les basaltes issus des dorsales océaniques (les MORBs ou Mid Ocean Ridge Basalt) et ceux qui sont issus des panaches (les OIB ou Ocean Island Basalts) ont des compositions différentes pour un certain nombre d'éléments chimiques présents dans le manteau. Cela indique que la composition géochimique du manteau terrestre est hétérogène. Les magmas créés par les panaches ont une origine différente de celles des magmas créés sous les dorsales. Les mesures géochimiques, de plus en plus nombreuses, montrent que les panaches contiennent une partie de croûte océanique subductée. Cette croûte est stockée dans le manteau pendant un temps très long, pouvant atteindre jusqu'à 1 à 2 milliards d'années, et retourne ensuite à la surface grâce à la remontée dans les panaches. La mesure des rapports isotopiques des gaz rares pour les basaltes des OIB semble indiquer aussi la présence de matériau moins dégazé, généralement considéré comme plus primitif, qui se trouve peut-être à la base du manteau terrestre.
Pour en savoir plus :
La Vie en catastrophes, de Vincent Courtillot, Ed. Fayard, 1995
Plusieurs équipes de l'IPGP étudient les panaches, avec des approches différentes: