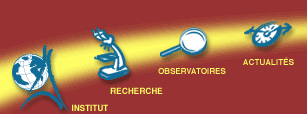


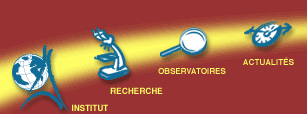 |
 |
 |
| |
|

La Terre, machine thermique
Stéphane LabrossePhD - Laboratoire de Géomagnétisme
Télécharger ce dossier
La Terre est une planète vivante, comme en témoignent les mouvements de tectonique des plaques, à l'origine des séismes et de la plupart des volcans. L'énergie nécessaire à cette dynamique provient du refroidissement de la Terre au cours du temps. La température de l'intérieur de la Terre est très élevée (environ 5000 K au centre de la Terre) et elle l'était encore plus à l'origine.
Par ailleurs, la Terre contient des éléments radioactifs qui produisent de la chaleur. C'est grâce à ces éléments radioactifs que la Terre est toujours une planète vivante, 4,55 milliards d'années après sa formation. Cette radioactivité naturelle produit de la chaleur et toute cette énergie des profondeurs de la Terre doit être évacuée. Cela se produit par convection thermique, c'est à dire que la matière est mise en mouvements et que ces mouvements transportent la chaleur. Ce sont ces déplacements que l'on observe à la surface de la Terre (voir la tectonique des plaques) et du noyau. Voyons plus en détail comment fonctionne cette machine thermique.
La sismologie nous a permis de sonder les profondeurs de la Terre et en particulier de voir que la Terre est composée de plusieurs enveloppes imbriquées dont les deux principales entitées sont le noyau (au centre) et le manteau qui l'entoure.
Le noyau est formé principalement de fer :
- solide dans la partie interne appelée la graine, d'environ 1200km de rayon
- liquide dans la partie externe.
Le manteau est formé de roches silicatées solides sauf en des zones très localisées où elles peuvent être partiellement fondues, et éventuellement donner naissance à des volcans.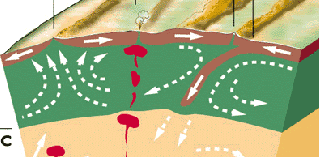
La convection dans le manteau
Le fait que le manteau soit solide ne l'empêche pas de se déformer sur les échelles de temps très longues de la géologie, le million d'année. A ces échelles de temps, il peut être considéré comme un fluide très visqueux.Pour comprendre ceci, il suffit de se rendre à Chamonix et d'aller voir la mer de glace. La glace est un solide et pourtant on peut la voir s'écouler sur l'échelle de temps de la dizaine d'année.
Dans le manteau de la Terre, le moteur des mouvements est la convection thermique. Le manteau contient des éléments radioactifs qui l'échauffent si bien que sa température augmente avec la profondeur. On se retrouve alors dans une situation instable : à la surface se trouve de la matière qui est plus froide et donc plus dense qu'à l'intèrieur du manteau. Le manteau se met alors spontanément en mouvement et l'expression en surface de ces mouvements est la tectonique des plaques.
Le plancher océanique se forme aux dorsales (ou zones d'accrétion) ou le manteau qui monte fond partiellement. En s'éloignant de la dorsale, la plaque océanique se refroidit et devient donc plus dense. A partir d'une certaine distance cette densité devient trop importante pour que la plaque soit stable à la surface. La plaque plonge alors dans le manteau au niveau d'une zone de subduction.
Ce cycle-extraction de manteau chaud au niveau des dorsales, refroidissement de la plaque, injection de la plaque froide au niveau des zones de subduction-extrait la chaleur de la Terre. Une partie du flux de chaleur extrait permet de se débarrasser de l'énergie produite par désintégration des éléments radioactifs contenus dans le manteau. Une autre partie sert à abaisser la température du manteau (le refroidissement séculaire). Enfin, une dernière partie permet d'extraire de la chaleur du noyau au travers de la frontière noyau-manteau (FNM).
Le refroidissement du noyau
Le noyau est composé principalement d'un alliage de fer et de nickel et de quelques éléments légers (S, Si, O, C) en proportions non complètement déterminées. La partie interne du noyau (la graine) est solide alors que sa partie externe est liquide. Cela signifie que la température dans le noyau augmente avec la profondeur (du fait de la pression) moins rapidement que la température de cristallisation. Au fur et à mesure que le manteau extrait de la chaleur du noyau, celui-ci se refroidit et cristallise vers le centre. Le rayon de la graine augmente donc avec le temps.
Durant la cristallisation d'une parcelle de fluide à la base du noyau externe, les élèments légers ne cristallisent pas dans la graine et sont ajoutés à la partie liquide du noyau. Le fluide qui se trouve à la base du noyau liquide devient alors moins dense que le fluide qui se trouve au sommet du noyau. Cette situation est instable et provoque le démarrage de mouvements de convection, appelée cette fois convection solutale ou compositionelle. Ces mouvements sont à l'origine du champ magnétique de la Terre.
Géotherme
On peut représenter la structure thermique de la Terre, en établissant la courbe de la variation de la température moyenne dans toute la Terre en fonction de la profondeur (ou du rayon, c'est à dire la distance au centre de la Terre, donnée ici en km). Cette courbe est une coube idéale, appelée géotherme. Pour obtenir une telle courbe, il faut savoir par quel mécanisme la chaleur est transportée et cette courbe n'est donc pas indépendante du modèle considéré.
Cette figure présente le cas d'un manteau qui convecte en une seule couche (voir l'article de M. Le Bars pour d'autres situations possibles). Le manteau est alors bien mélangé, ce qui tend à limiter l'augmentation de température avec la profondeur. Cette augmentation est cependant visible, et ce pour deux raisons différentes suivant la région considérée :
Il y a ainsi au moins deux couches limites dans le manteau : une à la surface qui peut être identifiée à la lithosphère et une à la base, appelée couche D'' par les sismologues. D'autres couches limites pourraient exister à l'intérieur du manteau, dans le cas d'une convection à deux couches.
Le noyau externe est liquide et transfère l'énergie par convection. La variation de température est donc principalement adiabatique. Il existe cependant deux couches limite à la frontière avec la graine (solide) et le manteau, mais ces couches limites sont trop fines pour être visibles sur cette figure. Dans la graine solide, la chaleur est vraisemblablement transportée par conduction.
Conclusion
L'étude du refroidissement de la Terre est encore (après plusieurs siècles d'investigation) un domaine de recherche très actif car il se trouve à l'intersection de toutes les disciplines de la géophysique de la Terre profonde.Pour en savoir plus : notes de cours du DEA de Geophysique interne
Mise à jour en Mai 2002